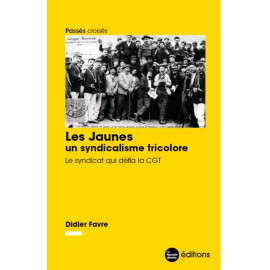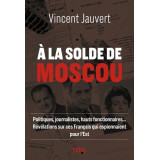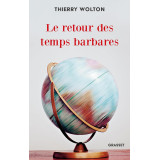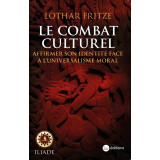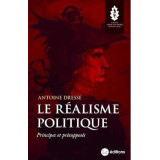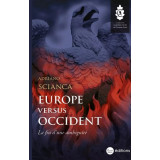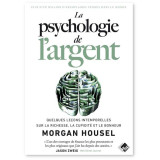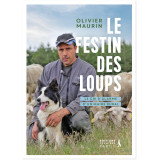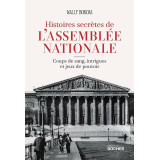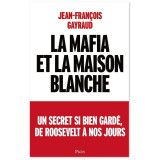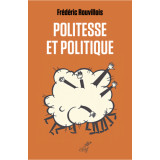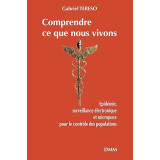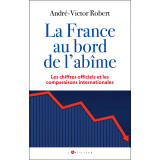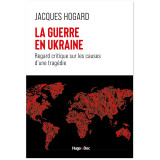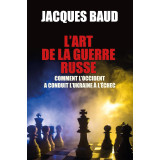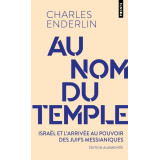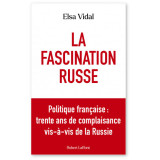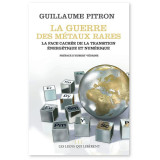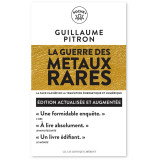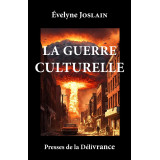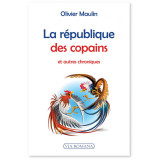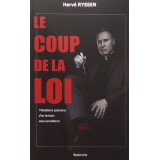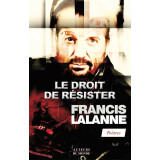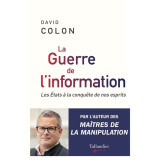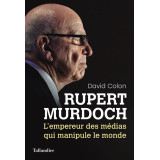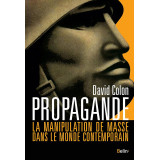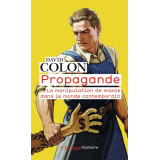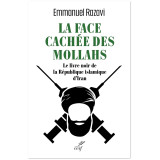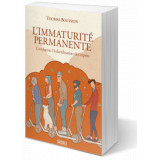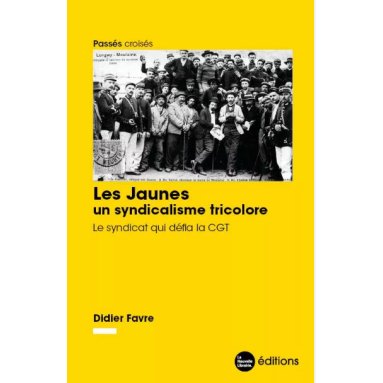
Dider Favre
Les Jaunes, un syndicalisme tricolore
Le syndicat qui défia la CGT
La courte et fracassante histoire d'une mouvance qui a marqué la fin de la Belle époque et laissé son empreinte sur l'imaginaire politique.
- Donner votre avis
En savoir plus
LE NOUVEAU PRESENT, février 2023 : Les lectures de Madeleine Cruz – Servez moi un jaune !
Sous la IIIe République (pas seulement, d’ailleurs), l’alcoolisme était un vrai fléau dans le monde ouvrier. Il suffit de relire L’Assommoir. Quand des ouvriers réclamaient un jaune, ou plus souvent, « un petit jaune », ils ne réclamaient pas l’aide d’un syndicaliste, membre du syndicat des Jaunes de France, mais un verre de pastis, boisson très populaire, en particulier dans le sud de la France (ma tante Mathilde ne crachait pas dessus, non plus). Il n’empêche qu’entre 1900 et 1910, « les Jaunes » ont désigné aussi des militants syndicaux se voulant à la fois sociaux et patriotes, et en tout cas en opposition frontale avec les rouges et la CGT.
Dans son livre Les Jaunes, un syndicalisme tricolore, Didier Favre nous raconte l’histoire de ce courant anticollectiviste, qui représenta un temps une force ouvrière puissante. Au départ, on trouve un personnage charismatique, Pierre Biétry. Maurras l’a présenté comme « un illusionniste », un « flibustier », « garçon intelligent à la langue bien pendue ». Il fut d’abord un meneur lors de grèves, en 1899, dans le Doubs. Mais, très vite, il s’oppose aux rouges, et prône un syndicalisme tricolore, inspiré des corporations, qui doit être mis au service de l’entente entre les catégories sociales, et de la diffusion de la propriété : les « Jaunes » (leur symbole était un gland jaune, ou encore le genêt, « la jolie fleur d’or [qui] pousse sur toutes les parties de notre sol français »). Pour les syndicats rouges, les Jaunes ne sont que des « suppôts du patronat », et Biétry « le serviteur des moines et des jésuites », mais une partie significative du monde ouvrier sera séduit par ce mouvement qui refuse les violences de ceux que l’on n’appelle pas encore les communistes. L’âge d’or de ce nouveau syndicalisme, préfiguration des syndicats indépendants, se situe entre 1904 et 1910. Puis Biétry se lance dans la politique, il crée son parti « propriétiste » et se retrouve député du Finistère, dans le cadre d’une coalition des droites, mais il meurt jeune (46 ans) et sans successeur.
Didier Favre nous raconte donc une aventure syndicalo-politique peu connue, qui aurait pu réussir car la diffusion de la propriété était un thème sans doute plus populaire dans le monde ouvrier de l’époque que la révolution universelle. Le mot d’ordre des Jaunes : « Il faut que tout le monde possède. » Zeev Sternhell classe les Jaunes parmi les courants français préfascistes dans son livre sur La Droite révolutionnaire 1885-1914. C’est un énorme contresens, nous dit en substance Didier Favre, car les Jaunes étaient très antiétatistes. Le fait de réunir au sein d’une même organisation plusieurs centaines de milliers d’ouvriers antirouges n’est vraiment pas suffisant pour en faire des précurseurs du fascisme. Les chansonniers se sont emparés de la confrontation Jaunes-Rouges, ce qui donnait à l’époque cette jolie chanson : J’ai la jauniss’, j’ai la jauniss’, J’aime la galett’ et l’ pain d’épice, Je marche avec les proprios, Je cir’ les bott’ et rince les pots ! J’ai la rougeole, j’ai la rougeole ; Ça m’ démange dans les guiboles, Tant qu’à turbiner pour mon pain, Zut ! Y m’ pousse un poil dans la main !
L'HOMME NOUVEAU, novembre 2022, Yves Chiron : Les « Jaunes » contre la CGT : un syndicat en dénonce un autre…
rs qu’une grève lancée par la CGT dans les raffineries et les dépôts de carburant a réussi à créer une pénurie d’essence pendant plusieurs jours, Didier Favre, spécialiste de l’histoire du syndicalisme, raconte l’histoire des « Jaunes ». Ces syndicats, bien oubliés aujourd’hui, ont pourtant connu un grand succès dans les premières années du XXe siècle. Ils sont nés en 1899 lorsque des ouvriers, hostiles aux grèves violentes menées par la CGT au Creusot et à Montceau-les-Mines, créent, avec l’appui du patronat, des syndicats indépendants. Le qualificatif de « Jaunes » provient du papier jaune qu’ils avaient dû employer pour remplacer les vitres de leur local brisées par les grévistes. En 1902, il y aura 317 syndicats jaunes dans tout le pays, qui s’organiseront en fédération. La CGT dénoncera ces syndicats « au service du patronat ». En réalité, les Jaunes, hostiles au socialisme révolutionnaire, voulaient défendre la liberté du travail et la liberté des entreprises. Ils refusaient la dialectique revendication salariale/grèves et affirmaient que « si l’ouvrier a des droits à faire valoir, il a aussi des devoirs à remplir ».
Contre ce qu’ils appelaient « la gréviculture », les syndicats jaunes demandaient une institutionnalisation de l’« arbitrage » dans l’entreprise. Les statuts de la Fédération nationale des Jaunes de France (FNJF) précisaient : « Les Jaunes s’engagent à ne faire aucune grève sans avoir donné par écrit leurs revendications et avoir attendu la réponse quinze jours au moins. » Pour améliorer la condition des ouvriers, ils voulaient favoriser leur accès à la propriété individuelle et impliquer davantage les salariés dans la vie de l’entreprise, ses résultats (par l’intéressement) et son capital (par la participation). Ils demandaient aussi la générali sation d’un système de retraites, contrôlé par l’État mais pas géré par l’État. Ce syndicalisme non socialiste, indépendant, proche des organisations nationalistes de l’époque, a représenté à un moment un réel phénomène de masse (jusqu’à 375 000 adhérents en 1907). Pourtant il s’est vite effondré, dès 1909- 1910. Dans son étude historique très claire, Didier Favre donne plusieurs raisons, notamment « l’ambiguïté jamais résolue entre la lutte syndicale et le combat politique ».
Pierre Biétry, le leader du syndicalisme jaune, avait réussi à se faire élire député en 1906. Il fondera le Parti propriétiste. Certaines propositions du syndicalisme jaune, notamment l’intéressement et la participation, seront reprises plus tard par d’autres organisations ou partis politiques.
________________
Au sommaire :
- Les fondements de l'idéologie jaune
- Pratique du syndicalisme jaune
- Comment vaincre le désordre économique t social
- Organiser la nation
- Un apolitisme impossible
- Aspects du nationalisme jaune
- Les jaunes et l'étranger
- Conclusion
- Annexes
- Bibliographie
4ème de couverture
Au début du XXe siècle, émerge au sein de la classe ouvrière une alternative qui va se développer de façon fulgurante malgré les attaques répétées et violentes des "Rouges" : les syndicats jaunes. En réaction au syndicalisme révolutionnaire de la CGT et porté par le charismatique Pierre Biétry, tribun tonitruant qui sera élu député, ce mouvement prend les formes d'une droite populaire et cocardière.
Son programme : la collaboration de classes, l'antiétatisme et la volonté de supprimer le prolétariat en l'intégrant dans la communauté nationale. Soutenus par les milieux intellectuels de droite et une partie du patronat, les Jaunes se dotèrent de leur propre matrice idéologique, le "propriétisme", et finirent par épouser les thèses du nationalisme français.
Didier Favre nous présente dans cette étude la courte et fracassante histoire d'une mouvance qui a marqué la fin de la Belle époque et laissé son empreinte sur l'imaginaire politique.
Fiche technique
| Catégories | Livres Sciences Politiques Actualité/ Etudes / Essais |
| Éditeur | La Nouvelle Librairie |
| Reliure | Broché |
| Parution | Octobre 2022 |
| Nombre de pages | 186 |
| Hauteur | 19 |
| Largeur | 12 |
| Épaisseur | 1.3 |
| Poids | 0.185 kg |